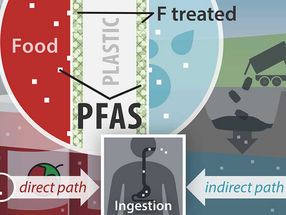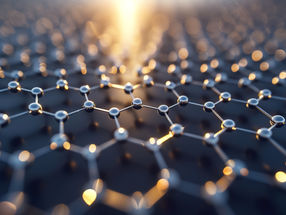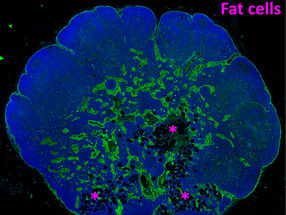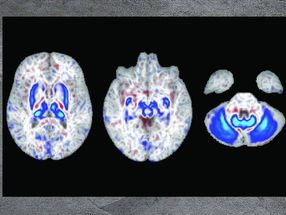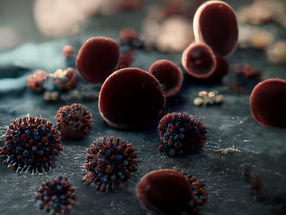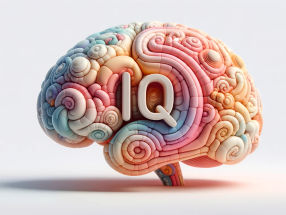Les nanoplastiques à l'assaut du ciel
Des chercheurs détectent des particules microscopiques de plastique sur les glaciers alpins avec l'aide des alpinistes
Les nanoplastiques - particules de plastique d'une taille inférieure à 1 µm - sont largement dispersés en raison de leur faible poids. Une équipe de recherche coordonnée par le Centre Helmholtz pour la recherche environnementale (UFZ) vient de publier un article dans Scientific Reports qui montre à quel point les glaciers situés à plus de 3 000 m d'altitude dans les Alpes sont pollués par les nanoplastiques. Les chercheurs ont fait appel à la science citoyenne pour collecter les données. Des alpinistes ont prélevé des échantillons sur les glaciers.
Les nanoplastiques sont créés principalement par la dégradation des macro- et microplastiques dans l'environnement - par des processus de décomposition abiotiques et biotiques tels que les enzymes, l'oxydation, l'hydrolyse et l'abrasion mécanique. La contribution des macro- et microplastiques à la pollution de l'environnement a fait l'objet de nombreuses recherches. En revanche, on en sait beaucoup moins sur les particules nanoplastiques, qui peuvent présenter des risques encore plus grands pour l'homme. "Les nanoplastiques sont particulièrement préoccupants car, contrairement aux microplastiques, ils ne sont pas filtrés. L'homme peut facilement inhaler les particules qui, en raison de leur petite taille, peuvent traverser les membranes et pénétrer dans la circulation sanguine", explique le Dr Dušan Materic, responsable scientifique du projet et chimiste à l'UFZ.
En raison de leur faible poids, les nanoparticules peuvent être transportées sur de longues distances dans l'atmosphère. Cependant, on manque encore d'études globales sur la manière dont elles atteignent les régions éloignées des centres industriels et urbains. Dans le cadre de leurs travaux de recherche, Materi ? et ses collègues ont étudié le degré de contamination des glaciers alpins par les nanoparticules et les sources dont elles proviennent.
Les chercheurs ont d'abord dû prélever des échantillons à plus de 3 000 mètres d'altitude. "Pour les chercheurs, il n'est guère possible et souvent trop dangereux de se rendre dans ces régions. Il faut non seulement du temps pour de longues excursions et des connaissances locales spécialisées, mais aussi et surtout une bonne condition physique pour pouvoir passer plusieurs jours à voyager sur les glaciers avec un lourd sac à dos", explique Leonie Jurkschat, premier auteur de l'étude.
Les scientifiques ont donc collaboré avec une équipe d'alpinistes. Le long de l'itinéraire historique de haute montagne de Chamonix (France) à Zermatt (Suisse), ils ont prélevé de la neige et de la glace sur les glaciers à 14 endroits en France, en Italie et en Suisse, à l'écart des sentiers de randonnée touristiques, et ont ensuite envoyé les échantillons à l'UFZ pour analyse.
"Les alpinistes ont retiré la glace de la couche supérieure du glacier car nous voulions analyser l'exposition aux nanoplastiques au cours des dernières semaines", explique M. Materic. Pour éviter toute contamination, les chercheurs de l'UFZ ont formé les alpinistes lors d'ateliers en ligne. Par exemple, les grimpeurs devaient utiliser de nouveaux vêtements et de nouvelles cordes, l'échantillonneur devait toujours être le premier de l'équipe de cordée et l'échantillonnage devait être effectué le plus rapidement possible afin d'éviter toute contamination.
Lors de l'analyse des échantillons à l'UFZ, les chercheurs ont utilisé un spectromètre de masse à réaction de transfert de protons (PTR-MS) à haute résolution, qui est couplé à la désorption thermique (TD) et mesure les concentrations de gaz traces organiques. Le TD-PTR-MS brûle le plastique présent dans les échantillons. Le spectromètre de masse quantifie les gaz libérés lors du chauffage. Chaque polymère produisant une sorte d'empreinte de gaz, il est possible d'en déterminer l'identité et la concentration. Les chercheurs de l'UFZ ont principalement trouvé de l'abrasion de pneus et les plastiques polyéthylène (PE) et polystyrène (PS) dans les échantillons de glaciers, tandis que le polyéthylène téréphtalate (PET) a été trouvé beaucoup plus rarement. Au total, les chercheurs n'ont pu détecter des nanoplastiques qu'à cinq endroits sur 14. "Cela montre que toutes les zones d'un glacier ne sont pas polluées. Lorsque le vent est particulièrement fort, les nanoparticules sont emportées et s'accumulent à nouveau dans les zones du glacier qui sont plus à l'abri du vent", explique M. Materic. Les concentrations de nanoplastiques sur les cinq sites étaient de 2 à 80 ng/ml de neige fondue.
Les chercheurs de l'UFZ ont également voulu savoir d'où provenaient les particules nanoplastiques détectées. Pour ce faire, ils ont collaboré avec des collègues du NILU en Norvège. Ils ont utilisé le modèle de dispersion des particules "Flexpart" pour modéliser et analyser le transport atmosphérique des particules. En tenant compte de divers paramètres tels que le vent, la température, la couverture nuageuse et la pression atmosphérique, ils ont pu modéliser l'origine la plus probable des nanoplastiques de tailles, de densités et de poids différents en fonction de l'endroit où ils ont été trouvés sur le glacier. "Les nanoparticules sont virtuellement envoyées vers leur lieu d'origine dans le cadre de la modélisation", explique M. Materic. L'équipe de recherche a découvert que les nanoplastiques sont très probablement transportés vers les glaciers alpins depuis l'ouest et qu'ils s'y déposent. Aux endroits où des nanoplastiques ont été trouvés, plus de 50 % des particules proviennent de l'Atlantique. "Il y a beaucoup de macroplastiques et de microplastiques dans la mer. Ils se décomposent en nanoplastiques, sont entraînés par les vagues et l'éclatement des bulles et finissent par pénétrer dans l'atmosphère", explique M. Materic. Côté terre, la plupart des particules proviennent de France (plus de 10 %), suivie de l'Espagne et de la Suisse.
Pour en savoir plus sur la pollution des glaciers par les nanoplastiques, Materic a accepté le rôle de directeur scientifique du projet Citizen Science GAPS 2024. L'objectif est d'amener des équipes d'alpinistes à collecter des échantillons sur les glaciers du monde entier. Ces échantillons seront ensuite analysés à l'UFZ. Certains, provenant par exemple de l'Antarctique, de la Nouvelle-Zélande ou de l'Himalaya, sont déjà arrivés dans les laboratoires de l'UFZ et attendent d'être analysés.
Note: Cet article a été traduit à l'aide d'un système informatique sans intervention humaine. LUMITOS propose ces traductions automatiques pour présenter un plus large éventail d'actualités. Comme cet article a été traduit avec traduction automatique, il est possible qu'il contienne des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. L'article original dans Anglais peut être trouvé ici.